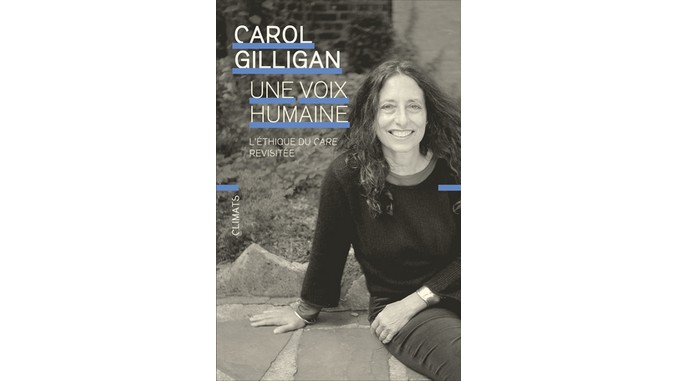Titre : Une voix humaine
Autrice : Carol Gilligan
Editions : Flammarion Climats
Date de parution : 10 avril 2024
Genre : Psychologie, Psychanalyse
En 1982, sort un livre qui marquera les sciences humaines et le féminisme : « Une voix différente » de Carol Gilligan. Quarante ans plus tard, l’autrice continue sur sa lancée en apportant les conclusions qu’elle tire de ses cours de psychologie morale (entre autres) et de ses diverses enquêtes : ce n’est pas une voix différente au sens de féminine, uniquement portée par les femmes, mais une voix humaine, qui provient des tréfonds de tout être humain, dont nous avons besoin.
Gilligan part d’un constat : son livre fracassant des années 1980 a laissé la place à des débats sur l’essentialisation du care, du « prendre soin » : or, au lieu de dire que seules les femmes savent prendre soin, s’occuper des autres, il est urgent de dire que le care n’est pas l’apanage naturel des femmes. C’est ce qu’elle démontre dans ce livre, « Une voix humaine. L’éthique du care revisitée », composé de courts chapitres écrits à divers moments de sa vie, rassemblés pour l’occasion.
L’autrice raconte comment les jeunes filles (en particulier ici) et les garçons apprennent à néantiser leur voix intérieure, leur voix d’être humain, pour mieux pouvoir relationner dans ce monde où le système genre bicatégorise tout en deux, le masculin et le féminin, avec une hiérarchie où le féminin a peu de valeurs face au masculin. Les filles apprennent donc à être calme, à l’écoute des autres avant de s’écouter elles-mêmes, à mettre en sourdine leur désir sexuel tandis que les garçons se coupent progressivement de partager leurs émotions intimes pour mieux devenir des hommes, des « vrais ».
Gilligan, psychologue de formation, expose les questions qu’elle pose à ses jeunes filles pour leur faire réaliser ce qu’elles souhaitent vraiment (de leur vie) en dehors des attentes genrées. Elle mentionne le cas d’Anne Frank et de la révision de son journal par elle-même puis par son père, pour enlever des pages « gênantes » comme l’éveil sexuel. Elle revient aussi sur Greta Thunberg et Darnella Frazier, une ado qui a filmé la mort de George Floyd en direct, qui ont mis de côté ce qu’on attendait d’elles pour exprimer leurs voix.
Elle s’intéresse aussi à de multiples autres récits, comme l’histoire d’Adam et Eve ainsi qu’à des films (Phantom Thread, BlacKkKlansman, Sur le chemin de la rédemption) pour montrer qu’une autre vision est possible, une autre manière d’être, indépendamment des limites apposées socialement en fonction de notre genre. Prendre appui sur ces films (et sur le long-métrage belge Close qu’elle mentionne très justement) pour montrer l’espoir que ces productions mises en scène par des hommes (qu’elle dit aussi hétérosexuels) lui inspirent me semble plutôt naïf. Elle ne revient ainsi pas sur les approches multiples avec lesquelles on peut aborder une œuvre cinématographique (en interrogeant par exemple aussi la classe sociale de leur public cible).
Le livre nous transporte par l’optimisme et l’enthousiasme de l’autrice. Son écriture est limpide, agréable et très accessible malgré son académisme. L’introduction est tellement riche et bien écrite qu’elle dessert peut-être la force générale du livre dans le sens où le même propos est répété durant 160 pages, sur l’éthique du care, la justice, la morale et l’écoute radicale. On aurait pu espérer avoir accès à davantage « d’exercices » pratiques ou d’exemples vécus pour apprendre à « révéler » cette voix non genrée à l’intérieur de nous-même. Mais si cette théorie ressemble à du développement personnel nébuleux, l’autrice s’en éloigne pourtant en revenant toujours au macro, au sociétal, au patriarcat qu’il s’agit donc de démanteler en laissant libre cours à nos émotions et à notre intelligence rationnelle, dans l’écoute de l’autre et de soi-même.