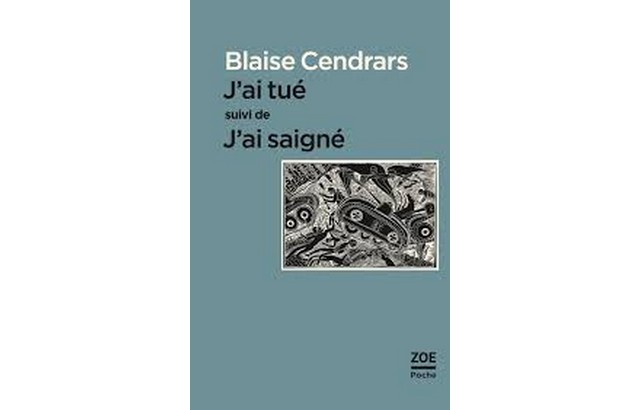auteur : Blaise Cendrars
édition : Zoé
sortie : avril 2015
genre : roman
Le Suisse Frédéric-Louis Sauser, resté dans l’histoire comme l’écrivain-aventurier français Blaise Cendrars, a publié au lendemain de 14-18 le court récit J’ai tué. Vingt ans plus tard, il sort J’ai saigné dans le recueil La Vie dangereuse. Aujourd’hui les éditions Zoé réunissent ces deux textes et les font précéder d’une très bonne préface de Christine Le Quellec Cottier.
L’ouvrage ressemble à un petit carnet de notes mais contient en réalité un gouffre : une plongée courte, intense, dans la Première guerre mondiale. En août 1914, l’auteur suisse des Pâques (1912) et de la Prose du Transsibérien (1913) décide de s’engager sous le drapeau bleu-blanc-rouge. À la clé, sa naturalisation française, mais aussi la perte de sa main d’écriture lors de l’offensive de Champagne de septembre 1915 ; son bras droit devra être amputé.
Deux faces d’une même monnaie, celle du prix fort de la guerre, J’ai tué et J’ai saigné sont néanmoins très différents. Le premier est brusque, instantané. Cendrars utilise des phrases courtes ou entrecoupées d’énumérations et de virgules. Il nous perd dans le tourbillon impersonnel de l’humanité et révèle soudainement l’individu, le « je » dont la pulsion de vivre l’emporte. Par un enchaînement de phrases implacables il fait glisser notre esprit jusqu’à la lame qui tue l’ennemi, l’Allemand.
Le deuxième récit révèle une prose plus romanesque. Malgré l’horreur de la situation, Cendrars évoque sans misérabilisme son évacuation et son rétablissement dans un évêché transformé en hôpital. Son expérience balise le récit qu’il fait des autres blessés qui l’entourent. Le malaise est palpable avec la dévotion sans limites de l’infirmière Adrienne et atteint son paroxysme quand le « pauvre petit berger des Landes » succombe au sadisme technique du général.
Ce petit recueil prouve que deux courts textes valent mieux que de longs discours pour donner un aperçu de ce que l’on avait illusoirement appelé « la der des der’ ». Mais Cendrars reste centré sur son écrit et ne verse ni dans l’apologie ni dans la diatribe de la guerre. De la main gauche, il livre « un témoignage littéraire, la représentation d’un vécu ». Et si à la manière d’un Céline il sait convoquer l’écœurante organicité de la mort et de la violence – « On voit […] des terrines pleines de choses sans nom, du jus, de la viande, des vêtements et de la fiente. » (J’ai tué, p.27) – il sait aussi terminer le récit d’un ravage de vies et de chairs par un élan d’affection, prouvant que des cendres peut renaître l’envie de vivre.